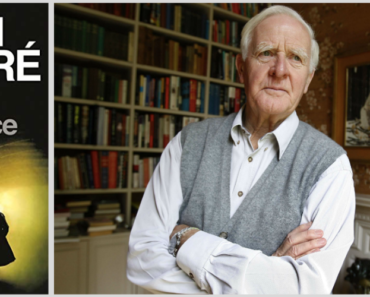De Nice à Montréal, en passant par Rome et Prague, Claire Legendre est une autrice cosmopolite, une voyageuse invétérée. Nourrie par les différentes cultures dont elle s’est imprégnée, l’autrice expatriée au Canada transmet à ses lecteurs son goût prononcé pour l’écriture mais défend, également, les causes qui lui tiennent à cœur. Nous avons profité de quelques minutes de son temps libre pour lui poser quelques questions…
-
Vous avez animé un atelier d’écriture à l’institut français de Prague avant de partir enseigner la création littéraire à l’Université de Montréal. Quelles sont les personnes qui participent à vos cours ? Qu’est-ce qui anime généralement vos élèves ?
Oui, et j’enseignais déjà l’écriture créative (entre autres) à l’Université de Nice. J’ai eu affaire à différents publics, dans le cadre de l’université c’est toujours un peu délicat car il faut transmettre des connaissances et un savoir-faire, donner des notes, alors qu’à l’Institut français de Prague, par exemple, c’était très libre, les participants venaient de tous horizons, Tchèques francophiles et Français mélangés, mais aussi des Russes, Bosniaques, Belges, Slovaques… de tous âges et tous milieux. Ils venaient pour le plaisir d’écrire en français et stimuler leur créativité.

Claire Legendre par © Lou Scamble
C’était très riche ce melting-pot et l’atmosphère y était très amicale. A l’Université on a une majorité de jeunes gens qui étudient les lettres et la scénarisation, ce qui est passionnant c’est de pouvoir les accompagner parfois durant des années, jusqu’à la maîtrise ou au doctorat en recherche-création, qui donnent souvent lieu à des romans publiés. Plusieurs de mes étudiants ici sont des écrivains publiés. C’est très gratifiant, et surtout c’est intéressant de travailler avec eux, car ils sont des partenaires de réflexion à part entière. C’est stimulant de les voir cheminer et de les accompagner dans leurs recherches.
-
Vous êtes ambassadrice de la littérature française à l’étranger, qu’est-ce que cela représente pour vous ?
Ambassadrice, je ne sais pas. Ce serait une lourde responsabilité. Je me sens véritablement immigrée, avec tout ce que ça comporte d’enrichissement culturel et de déracinement. C’est intéressant pour la langue, par exemple : je parle et j’écris en français une langue unique, mâtinée de Québec, d’Occitanie, d’italien, de l’argot marocain de mon père, de tournures tchèques, etc. Je suis au carrefour de cultures qui me nourrissent. En tant que prof, peut-être que je joue davantage ce rôle, en faisant lire à mes étudiants des auteurs peu étudiés jusque-là au Québec par exemple : il y a quelques années, mettre au programme Edouard Levé, Alexiévitch ou Doubrovsky, qui ne sont pas forcément étudiés en création, c’est une manière de semer. J’ai invité des auteurs français comme Thomas Clerc, Catherine Cusset, Mathieu Simonet, à venir dans mon séminaire. Là oui, je joue un rôle de passeur entre des cultures, des zones géographiques.
-
Villa Medici à Rome, Nice, Prague, Montréal… Votre vie cosmopolite a-t-elle une influence sur votre écriture ?
Oui, au niveau de la langue, qui est en constante évolution, et la mienne s’est modelée à mesure que j’ai changé de pays, mais surtout mes romans ont été enrichis de ces déplacements comme on prend conscience du monde à mesure qu’on apprend à le connaître. Quand j’avais 17 ans, Françoise Verny, la première à m’avoir lue chez Grasset, m’avait dit de voyager, de m’ouvrir à l’altérité… je crois avoir plus que suivi ce conseil. J’ai continué d’écrire l’intime, mais avec une profondeur de champ un peu différente. Tout ce qui se passe dans la vie a une influence sur l’écriture. Les rencontres, la distance, changent la façon de vivre, donc d’écrire. D’un point de vue romanesque, le changement est une chance !
-
Comment en vient-on à décider de consacrer sa vie à la littérature ? Avez-vous grandi dans une famille littéraire ? Quels sont les écrivains qui ont peuplé votre enfance ?
Mon père a ouvert son théâtre quand j’avais 5 ans. J’ai grandi dans ce contexte, à la fois ambitieux, parce que tout y était possible et infini, et très difficile, car faire fonctionner un théâtre non subventionné à Nice pendant 26 ans relève du défi, surtout quand il s’agit de monter du Arrabal, du Bergman, Pessoa, Beckett… Mon père a monté son premier Molière parce que j’avais vu à la télé qu’il y avait un rôle de petite fille dans Le Malade imaginaire et que j’étais tout excitée à l’idée de le jouer. C’était une belle et courageuse aventure, qui m’a transmis, au-delà des auteurs et des textes, une exigence morale, une intégrité en tant qu’artiste. Ma mère est une très bonne lectrice. Elle m’a fait lire Colette, Annie Ernaux… Aujourd’hui encore mes parents lisent la rentrée littéraire avant moi. Moi, je m’amuse. Je lis surtout pour écrire, et pour enseigner. L’écriture romanesque a toujours été mon terrain de jeu. J’étais fille unique, c’était pratique.
-
On dit souvent que les auteurs mettent une part d’eux-mêmes dans leurs écrits. Vérité et amour et Nullipares en sont-ils de bons exemples ? Qu’en est-il de vos romans plus sombres tels que L’écorchée vive ou Viande ?

On ne peut mettre dans nos livres que ce qu’on a, ce qui nous constitue. Tous mes livres me ressemblent, ceux qui semblent autobiographiques et ceux qui le paraissent moins. Si vous ne voyez pas le lien, c’est qu’il est mieux caché, c’est tout (rires) ! Je trouve parfois un peu pathétiques ces auteurs qui transposent comme pour cacher un sein : l’écrivain devient musicien ou cinéaste, la ville d’origine est celle d’à-côté… j’ai toujours envie de leur dire : je t’ai reconnu ! Ça ne veut pas dire que je raconte toujours ma vie dans mes livres, dans deux d’entre eux (Nullipares, un collectif que j’ai dirigé, et Le nénuphar et l’araignée), c’est assumé : ce ne sont pas des romans et j’y parle en mon nom.
Mais dans un roman, je considère que tout doit avoir du sens, qu’une transposition doit valoir pour ce qu’elle donne à voir, pas pour ce qu’elle cherche à cacher. L’écorchée vive parle d’une petite fille au visage déformé, qui subit adulte une greffe de visage. Viande parle d’une jeune fille à qui il pousse un sexe d’homme. Ces deux livres sont parmi les plus intimes que j’ai écrits. La fiction n’est pas un paravent, elle peut être un étendard ou un porte-voix.
-
Bermudes, votre nouveau roman, a paru cet automne au Québec. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ? Quel est le lien avec votre film Bermudes (Nord) ?
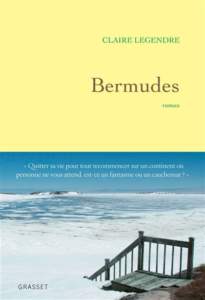
Bermudes raconte le parcours d’une écrivaine qui tente d’écrire la biographie d’une autre, qui a disparu. La disparue, Nicole Franzl dite Franza, s’est absentée d’un cargo en 2005, sur le Saint-Laurent, et l’on ignore si elle est morte ou si elle a recommencé sa vie, cachée, autrement. Sa biographe n’a que très peu d’éléments, alors elle puise dans sa propre vie pour essayer de comprendre l’autre. Et ce sont ses douleurs, ses désirs, qu’elle démasque au fil de son enquête. C’est un livre mélancolique et sensuel, que j’ai mis longtemps à écrire, parce qu’il m’a accompagnée durant mes premières années ici au Québec. J’ai pensé un temps aller l’écrire dans les Bermudes, le lieu mythique des disparitions.
Puis en voyageant au Québec j’ai découvert l’île d’Anticosti, au milieu du Saint-Laurent, elle est aussi grande que la Corse mais elle compte 200 habitants. C’est un lieu unique, et, dans l’histoire, un « cimetière des navigateurs » car on y compte plus de 400 naufrages. Anticosti est devenu une sorte de Bermudes du nord pour moi. Et ses habitants m’ont accueillie très généreusement, ils m’ont fait confiance en acceptant de me raconter leur histoire. J’y suis allée tourner un documentaire, Bermudes (Nord) en 2017, et ce film a inspiré toute une partie du livre. C’est donc la première fois que j’écris un roman dont certains personnages existent vraiment, portent de vrais noms, prononcent des paroles authentiques. Cela a constitué une expérience passionnante. La fiction et la réalité sont de vieilles catégories qui méritent d’être décloisonnées. Aujourd’hui, ou peut-être depuis toujours, tous nos jeux les plus intéressants consistent à mêler les deux.