Jérôme Bonnetto, auteur du très beau livre La Certitude des pierres paru en janvier 2020, a pris le temps de faire une pause dans l’écriture pour nous confier quelques mots. C’est avec une grande éloquence qu’il nous livre les dessous de fabrication de son roman, quelques-uns de ses auteurs préférés et l’influence de sa vie d’expatrié sur son imaginaire…
· La Certitude des pierres récolte coup de cœur sur coup de cœur. Comment décririez-vous la connexion que vous avez établie avec vos lecteurs ?
Cela fait naturellement plaisir quand le matin, on découvre un post élogieux ou un « coup de cœur » de libraire. En ce qui me concerne, la relation avec le lecteur se fait quasi exclusivement à travers le Net. Il y a des passionnés, des libraires, des blogueurs qui lisent, qui publient des recensions. Je reçois très peu de mails, mais j’ai ouvert deux « comptes fantômes » sur facebook et instagram pour suivre la réception du roman. Les réseaux sociaux donnent une vie à ce qui était auparavant invisible à l’auteur. Heureusement, parce que sans cela, publier un livre c’est presque abstrait, une fois qu’on a signé le bon à tirer, qu’on a distribué autour de soi ses exemplaires d’auteur, qu’on a rangé le sien sur son étagère, bon ben, c’est fini.

Il y a parfois un peu de presse, mais en dehors de cela on ne voit rien de ce qu’il se passe. Et c’est normal parce que lire c’est avant tout un acte intime. Il y a bien les salons, les signatures, mais cela reste des moments marginaux dans la vie d’un livre, surtout pour moi qui vis à l’étranger. La plupart du temps, il ne se passe rien. Si on ne se lance pas dans un autre projet immédiatement, on reste comme suspendu dans le vide, on attend Godot. Je suis très reconnaissant aux libraires et à ces lecteurs passionnés qui font vivre le livre en exposant leur expérience de lecture – ils apportent leurs propres références, proposent des éclairages intéressants, y compris pour moi. Vous me donnez l’occasion de les remercier.
· Le livre part d’un fait divers particulièrement choquant. Comment votre envie d’écrire un roman sur le sujet vous est-elle venue ?
L’affaire du berger de Castellar est bien connue par chez nous. Un soir, je suis tombé sur l’émission « Faites entrer l’accusé » qui retraçait l’affaire dans les détails. Ça a été un choc. Je connaissais le fait divers dans les grandes lignes, mais voir les visages des protagonistes, les entendre parler… J’ai eu une réaction épidermique. J’y ai perçu immédiatement la force du destin tragique. Mais cela ne faisait pas un roman.
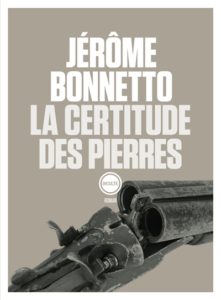
L’émission date de 2003, je vous laisse calculer. L’affaire ne me lâchait pas, j’y pensais souvent, j’en discutais autour de moi, c’était comme un caillou dans ma chaussure. Ça a été un long chemin. Il m’a fallu du temps pour prendre de la distance et m’autoriser les libertés nécessaires à l’écriture d’un roman. L’asservissement besogneux au réel, la littérature de reconstitution, l’auteur qui va enquêter pour savoir quelle était la couleur des chaussettes d’Untel… certains le font très bien, mais ce n’est pas trop mon truc. J’ai voulu faire autre chose, écrire cette histoire depuis la fiction, en multipliant les points de vue et en donnant sa chance à chaque personnage. Je crois aux pouvoirs de la fiction. Comment affirmer qu’un homme a pensé ceci ou a ressenti cela ? Sans la fiction, cela aurait été un cluedo d’hypothèses insupportable.
· Polar, western, conte moderne ?
Quand je sais à peu près où je vais, j’écris trois mots-clefs sur ma page de garde, cela me permet de ne pas oublier. À chaque fois que je prends mon manuscrit, cela fait une petite piqûre de rappel avant de me lancer. C’est important dans le processus d’écriture. Ce sont des principes esthétiques ou des notions qui doivent innerver tout le texte, non pas des références superficielles ici ou là, mais des courants de fond qui donnent son assise au récit. Pour La Certitude des pierres, j’avais écrit : tragédie, cinéma, conte. 2 sur 3, bravo !
Je suis un passionné de cinéma. Le western était une évidence : la dimension héroïque, l’opposition frontale, le duel bien sûr mais aussi l’isolement, l’âpreté des caractères, l’emprise du paysage sur les hommes. Je voulais que la montagne joue un rôle aussi important que les étendues désertiques des westerns. Je voulais qu’on la sente tout le temps là, actrice à sa manière de l’action. Dans les westerns, les réalisateurs utilisaient ce format tout en longueur qu’est le cinémascope pour capter les panoramas spectaculaires. C’est un cadre qui a priori convient mal aux gros plans et pourtant les réalisateurs ont compris qu’on pouvait en tirer un parti et on a commencé à filmer les visages de près. Le spectateur pouvait admirer ces tronches burinées comme des paysages. Je voulais que la nature et notamment la montagne soient comme un hors-champ constant, tout en limitant les descriptions au minimum parce que je ne suis pas Claude Simon non plus.
Le conte m’a également guidé. Il suffit de passer une semaine seul en montagne pour comprendre qu’on ne peut pas s’affranchir du merveilleux. Une pierre, le vent, la chaleur, les éléments qui interviennent pour agir ou commenter l’histoire. Dans un roman, on fait tomber un fruit, une pierre au bon moment et la montagne a déjà une âme. Mais le conte, c’est aussi cette matière universelle que porte chaque personnage. Il incarne toujours quelque chose qui le dépasse. Le conte partage ça avec le mythologique et même le biblique. Il faut asseoir une sorte de noyau fondamental qui meut les personnages tout en les faisant respirer, évoluer. C’est le plus difficile, il faut éviter la caricature dans des caractères pourtant bien trempés. J’ai voulu ménager une case veuve qui permet de faire bouger le dessin. C’est un travail qui m’a passionné.
La troisième clef était la tragédie. C’était la clef la plus évidente pour moi puisque l’histoire préexistait, comme chez Sophocle ou Racine. Il y avait tout : les unités de lieu et d’action, le destin, l’hybris, la catharsis… j’ai simplement ajouté un chœur et une sorte d’unité de temps avec la Saint-Barthélemy.
· Être publié est devenu difficile aujourd’hui. Quel a été votre parcours ? Comment s’est déroulée la recherche d’un éditeur ?
Ma première publication date de 2003, c’était chez L’Amourier. L’ « histoire » d’un cahier comme témoin poétique d’une relation amoureuse. C’est un recueil de poèmes écrit à quatre mains. Je me souviens d’être allé à une lecture de François Bon à Grasse uniquement pour remettre le manuscrit en mains propres à l’éditeur. Je ne l’ai envoyé à personne d’autre. C’était une bouteille à la mer. Et puis quelques mois plus tard, nous avons reçu un mail de Raphaël Monticelli – une personne formidable, je lui dois beaucoup – c’est le premier à s’être intéressé à ce que j’écrivais et ça compte. L’Amourier publie peu de livres, il nous a fallu attendre un an et demi avant la sortie. Quand on est éditeur et qu’on publie le recueil d’un jeune poète pas complètement dégrossi de 25 piges, on sait qu’on ne va pas réparer le toit de la baraque grâce aux ventes. Entre temps, la personne qui avait écrit la moitié du recueil s’est défaussée parce que la vie est comme ça. Ce livre, je l’ai assumé seul, presque comme une fiction.
Ensuite, L’Amourier m’a publié encore deux romans et entre les deux, nous avons sorti avec Claire Legendre un recueil de textimages chez son premier éditeur, Hors-Commerce, avec qui elle avait gardé de bonnes relations. Là, je ne me suis occupé de rien. La maison a fait faillite peu de temps après (pas à cause de nous, promis). On ne sait même pas combien on en a vendu. Et puis, j’ai commencé La Certitude et là je suis tombé dans un trou noir. J’avais composé 80 %, mais je n’arrivais pas à le terminer. Cela devenait douloureux alors je l’ai mis dans un tiroir et j’ai fait autre chose. Et puis le temps passe. Un jour, il est ressorti presque par hasard, lors d’un rangement de printemps et avec la distance j’ai enfin compris que l’un des problèmes était lié au choix du système de temps. Le roman était écrit au présent et cela ne fonctionnait pas avec la position de mon narrateur qui agit comme une éponge et prend en charge différentes voix. Il fallait allonger la distance avec l’action qui est suffisamment forte, l’éloigner un peu somme. Ça a fait vraiment « Eurêka ! » J’ai tout réécrit au passé et en trois mois, ça a été réglé. Je l’ai envoyé à pas mal d’éditeurs. Au fond, c’était la première fois que je me jetais vraiment dans le grand bain. Les éditions Inculte ont été les plus rapides. Je ne pouvais pas mieux tomber. Littérairement et humainement.
· Quel lecteur êtes-vous vous-même ?
J’ai été un lecteur très exigeant, impitoyable jusqu’à la bêtise parfois. Je me prenais pour un soldat de la guerre du goût. Il fallait que j’admire ou c’était le goudron et les plumes. Je ne disais jamais « c’est pas mal », ça n’existait pas dans mon vocabulaire. Ces lectures exigeantes m’ont construit au meilleur moment. Les gros livres monstrueux ne me font pas peur. J’ai enchaîné Ulysse de Joyce, Les Possédés de Dostoïevski et Les Somnambules d’Hermann Broch alors que la journée je tenais un stand de quads pour me faire un peu d’argent de poche. L’ensemble doit faire deux ou trois mille pages, mais ça ne me posait pas de problème. Vous savez des auteurs comme Guyotat ou Musil… L’homme sans qualités par exemple, on ne peut pas lire ça 50 pages par 50 pages à la lumière de sa lampe de chevet avant son petit dodo. Il faut s’y jeter à corps perdu et prendre des grandes lampées sans quoi on y passe deux mois et on ne comprend rien. J’étais capable de lire 6 à 8 heures par jour. L’expérience est forte si elle est concentrée dans le temps et quand on est jeune, on a besoin de ça. J’avais une soif d’alcoolo. Ma vue a rapidement baissé.
Aujourd’hui, je me suis bien assagi. Je lis moins, mais c’est plus varié. Je lis plus de littérature contemporaine. Je suis plus tolérant, plus ouvert. Je m’intéresse à plus de domaines aussi. Je lis même des biographies… Je trouve des petits bonbons partout, parfois une phrase, une image, une trouvaille me suffisent et sauvent la lecture. Quoi qu’il se passe, je n’abandonne quasiment jamais un livre, ça a dû m’arriver moins de dix fois dans ma vie. Je souffle, je marmonne, de temps en temps je lâche un gros mot (même dans le tramway !), mais je vais toujours au bout. Même sauter deux pages me pose un problème presque moral. Selon moi, ces moments d’ennui font aussi partie de la lecture. Les endurer nous permet parfois d’accéder à des subtilités qu’on n’imaginait pas. Je suis devenu un peu comme l’estomac d’une autruche, je casse même les pierres.
Je relis assez peu en intégralité, je feuillette plutôt. J’aime bien aussi m’engager totalement dans l’œuvre d’un auteur, lire les œuvres complètes. J’ai des périodes et j’enchaîne dix Thomas Bernhard, cinq Hrabal ou huit Echenoz. J’espère que je vais encore évoluer, que les lectures continueront de me changer, de sculpter mon regard sur le monde.
· Vous avez grandi à Nice et vivez maintenant à Prague. Quelles influences ont ces deux villes sur votre imaginaire ?
Nice, je m’en suis « occupé », comme on dit, dans mon deuxième roman, Le Dégénéré. C’est la ville de mon cœur parce qu’elle est magnifique et que les souvenirs de jeunesse sont souvent les plus émouvants. Les couleurs, la lumière, les parfums, la courbe de la Baie des Anges, je peux vous en parler pendant des heures. Vous pouvez m’envoyer mille ans en Patagonie, il me restera toujours un peu de bon Niçois que je garde précieusement. Mais ça n’excuse pas tout le reste… et il serait temps qu’on mette son nez pour de bon dans ce qu’il se passe là-bas.

Prague est une ville choisie. Je suis arrivé sur les rives de Vltava avec cette image du poète Vitezslav Nezval : « une citadelle volcanique taillée dans la pierre par un dément fébrile ». Il m’en reste toujours quelque chose et même si après douze ans, la quiétude du train-train prend le plus souvent le pas, il y a des percées de beauté irrésistibles qui fracturent le quotidien. Et alors, de nouveau, j’entends Nezval. Et puis il y a les gens, les rencontres que l’on fait, à Nice ou à Prague. Ça compte encore plus.
· Enseignant expatrié en République tchèque, quels sont les auteurs tchèques qui vous inspirent ?
C’est le genre de questions qui peuvent me donner des insomnies. Je pense à Georges Perec qui après avoir signé le bon à tirer de La disparition, son fameux roman sans « e », était réveillé chaque nuit par des visions d’horreur : un « et » oublié à la page 113 ou un « le » page 306.
Je vais essayer, mais sachez que demain ma réponse sera périmée. Je dois commencer avec les poètes (même si je considère que les genres sont poreux) puisque c’est avec eux que je suis entré dans la culture tchèque bien avant mon expatriation : Vladimir Holan, Nezval bien sûr qui incarne parfaitement la complexité du XXe – le génie poétique et l’aveuglement politique – Vera Linhartova, Egon Bondy ou Jiří Kolář. Au centre du Grand Roman trônent Bohumil Hrabal, Ladislav Fuks et Josef Skvorecky, je conseille aussi souvent Jiri Weil, Ota Pavel, Karel Pecka ou plus proche de nous Petra Hůlová ou Jachym Topol. Je vous balance un gloubi-boulga, mais je crois que les références, ce que vous appelez l’inspiration fonctionne un peu comme ça, comme une auberge. Ça se mélange, ça vient quand ça veut. Certains sont cachés dans l’armoire et pourtant ils sont bien là, tiens, je pense à ce roman tout à coup : Le Plafond, de Pavel Řezníček. J’adore ! Ou Trefulka. Ce sont tous des grands auteurs avant d’être des auteurs tchèques et je me garderai bien de refermer le sac et de coller une étiquette. Et pourtant… le tragi-comique, l’autodérision, la clairvoyance, une certaine manière d’aborder les choses par en dessous, on retrouve ça souvent dans la littérature comme dans le cinéma. On a énormément à apprendre d’une culture étrangère, quelle qu’elle soit, mais la littérature tchèque est une merveille. Si je vis à Prague aujourd’hui, c’est grâce aux artistes tchèques.
· Votre petit prochain ?
Je ne peux pas en dire grand-chose parce qu’il est encore dans le four, mais une bonne partie de l’histoire se déroule en Moravie dans une ville « moyenne ». Un hommage à la culture tchèque justement. Un roman sur l’identité, l’histoire d’une reconstruction personnelle, avec beaucoup d’eau et un peu d’art. Quelque chose d’un peu plus léger que d’habitude. Et des velléités comiques… je me marre tout seul pour l’instant, mais je suis incapable de deviner si cela va fonctionner sur les lecteurs.
Propos recueillis par Thomas Bordier






Entre polar et drame antique. Splendidement écrit!
Sélectionné pour le Prix des Chroniqueurs Toulouse Polars du Sud 2020: https://www.toulouse-polars-du-sud.com/category/prix